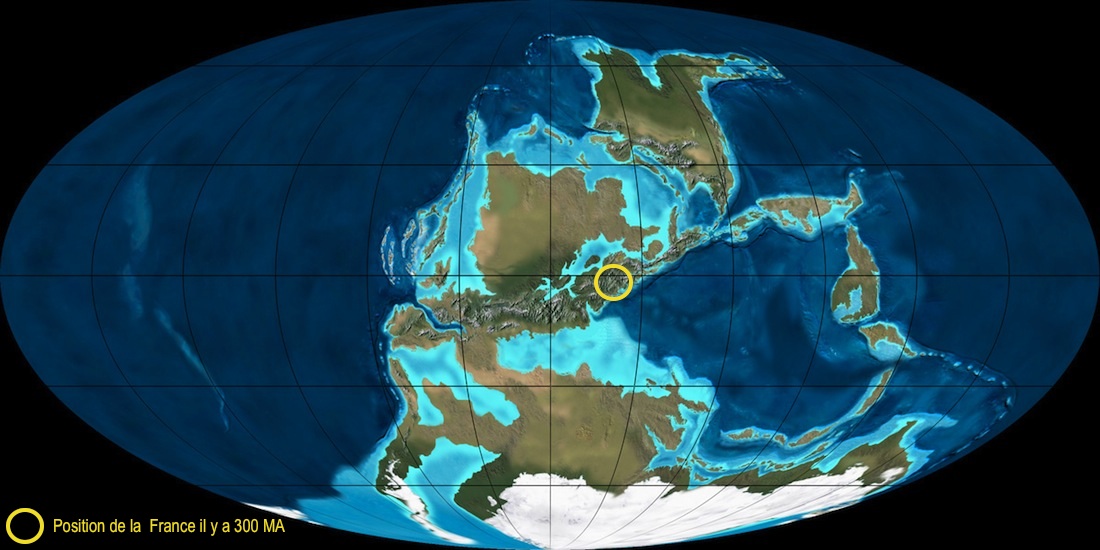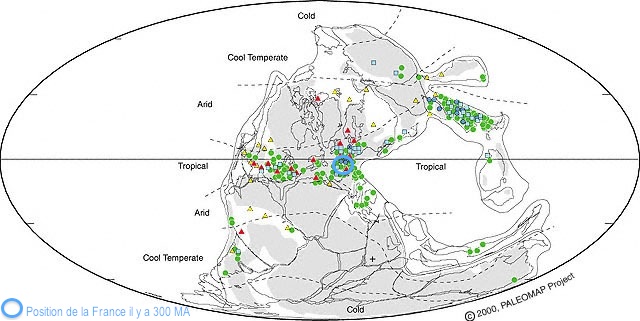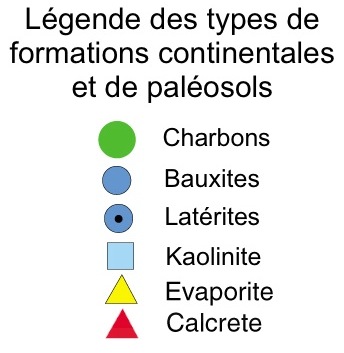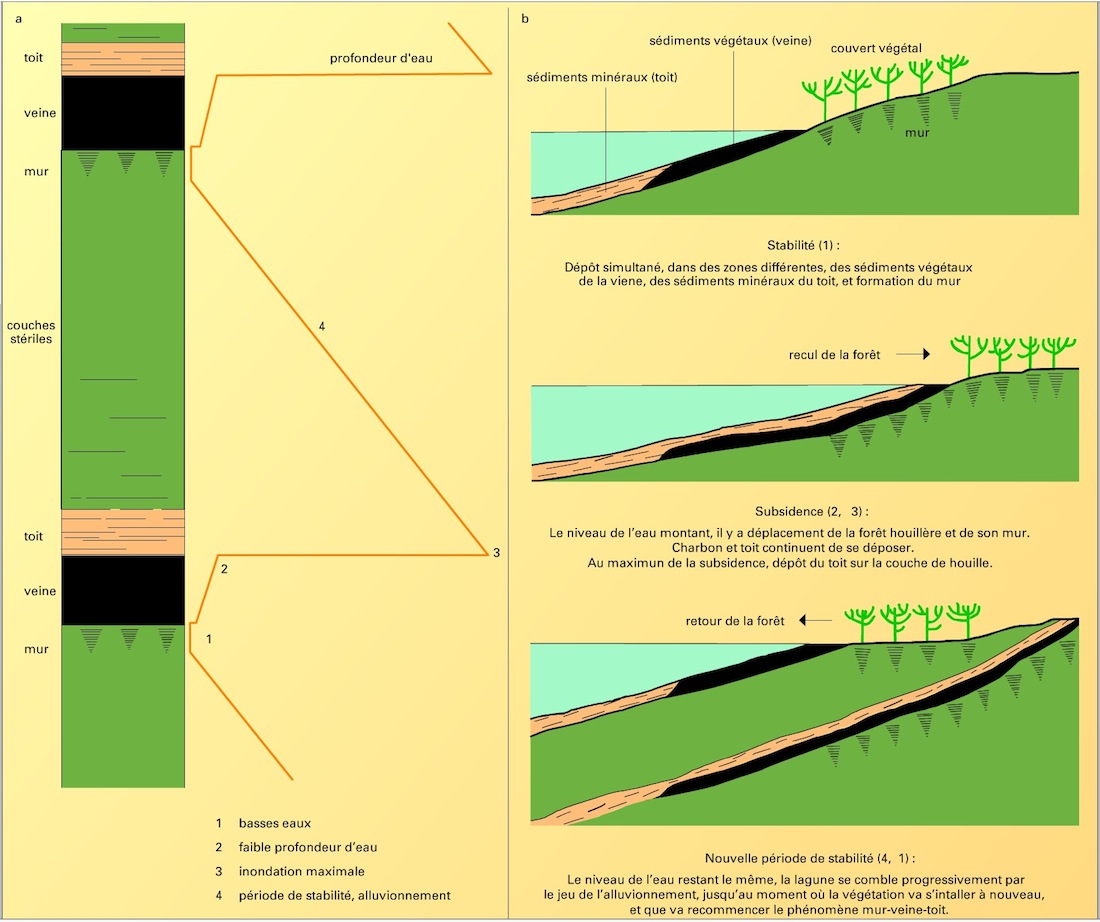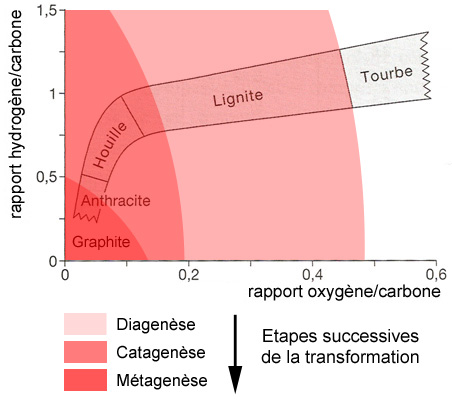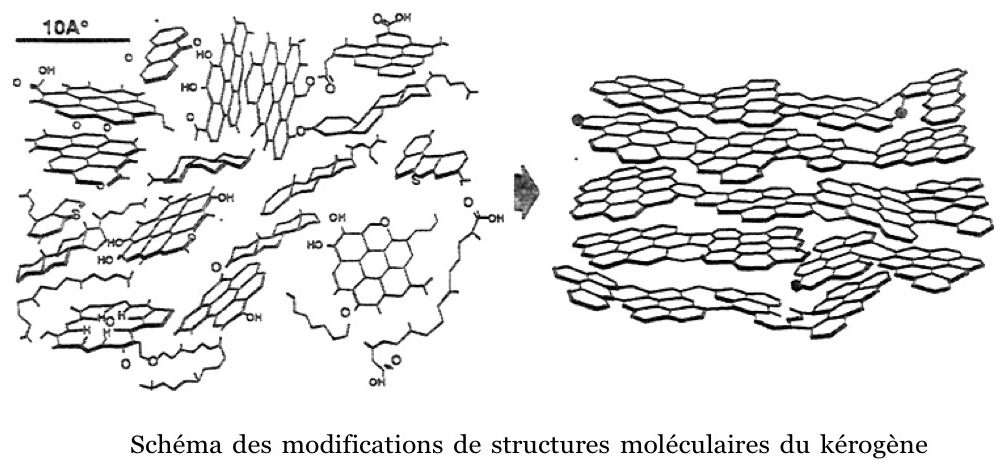|
I Les conditions ayant présidé à la formation
de charbon à Decazeville
1 - Les conditions ayant permis de produire une grande quantité de matière organique
Le paléoenvironnement a une forte productivité primaire en matière
organique : la flore fossile stéphanienne est abondante et riche. La faune, par contre, représentée essentiellement par des restes de
poissons dans la partie supérieure de l'assise de Bourran, est beaucoup
moins riche. Les fossiles collectés permettent ainsi de réaliser une
reconstitution du
paléoenvironnement de Decazeville à la fin du Carbonifère : il
s'agissait d'un biome de type forêt tropical humide, en bordure de
bassin sédimentaire continental laguno-lacustre (bassin dit limnique).
|
2
- Les conditions ayant protégé la matière organique de la décomposition
La tectonique extensive active du bassin est à l'origine d'une
subsidence avec enfoncement du fond, permettant l'accumulation rapide
et massive de sédiments sur la matière organique, isolant celle-ci et
la préservant de la minéralisation par décomposition.
Le rejeu épisodique des failles normales permet ainsi
la réalisation de cycles sédimentaires à plus ou moins grande échelle,
contrôlés par la tectonique.
A petite échelle, de tels cycles forment des séquences sédimentaires
répétées appelées cyclothèmes :
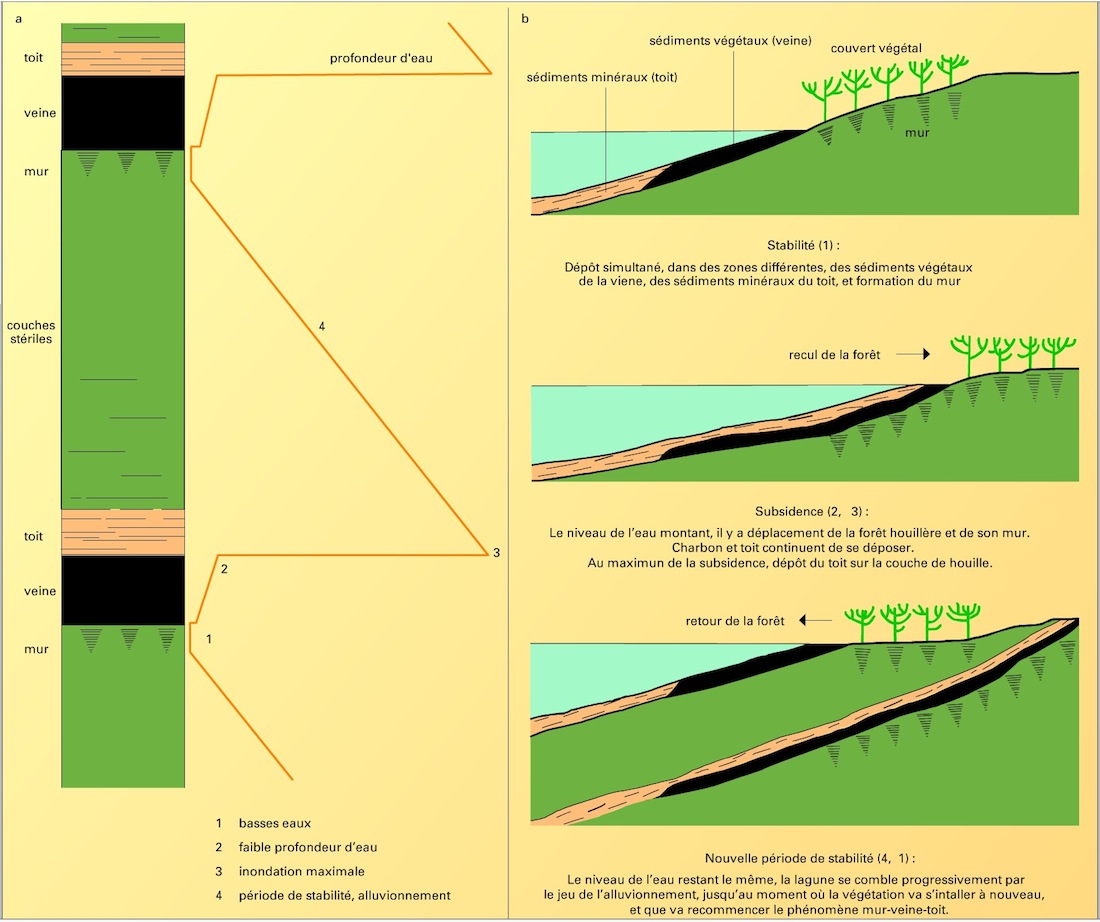
Crédit : 2005
Encyclopædia Universalis France S.A
La
séquestration massive de carbone dans une matière organique mal
décomposée peut aussi être attribuée à l'innovation qui apparait chez
des trachéophytes de l'époque : la lignine, composé polyphénolique
difficilement dégradable et à laquelle une adaptation efficace des
décomposeurs a mis du temps à apparaitre. (d'après R.A Berner)
|
3 - Les conditions ayant permis une fossilisation de la matière organique conservée
La subsidence active permet
aussi, par l'accumulation massive de sédiments, un enfouissement de la
matière organique : sous l'effet de la
pression lithostatique et du gradient géothermique, les molécules
organiques devenues instables réagissent en plusieurs étapes (diagenèse, catagenèse, métagenèse)
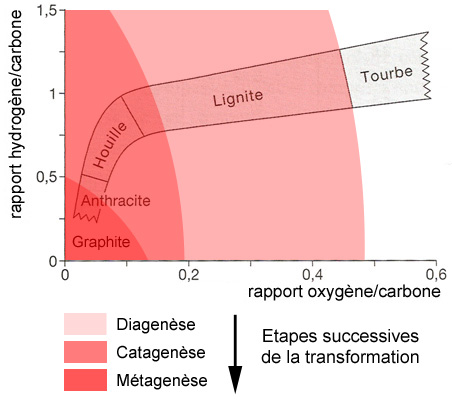
Diagramme de
Van
Krevelen, modifié
|
D'après
Durand,
1987
L'évolution de la composition chimique des roches carbonées montre une
réduction progressive des molécules : les roches sont de plus en plus
riches en carbone.
Des composés plus volatiles (hydrocarbures, gaz) sont également
générés, mais en plus faibles quantités du fait de la nature de la
matière organique d'origine, issue principalement de trachéophytes.
Conditions de la Diagenèse : entre 20 et 50 ° C pour une profondeur de
quelques centaines de mètres à 1000 m
Conditions de la Catagenèse : entre 50 et 150 ° C pour une profondeur
entre 1000 et 6000 m
Conditions de la Métagenèse : entre 150 et 250 ° C pour une profondeur
dépassant les 6000 m
Au delà de la métagenèse, les conditions de température et de pression
correspondent au champ du métamorphisme, dans lequel le graphite est
stable.
|
II Le contexte régional à l'origine de la
formation et de l'évolution du bassin limnique de Decazeville
|
L'ouverture du bassin de Decazeville, comme celle de nombreux bassins
limniques fini-carbonifères, est à mettre en relation avec la
pénéplanation par effondrement gravitaire de la chaine Hercynienne sur
la fin de son orogenèse.
Avant la sédimentation stéphanienne, le bassin de Decazeville se situe à un carrefour d’accidents tectoniques.
Les premiers sédiments vont donc s’accumuler sur une surface
compartimentée, facilement déformable selon trois directions
principales :
- Nord-Sud, N 10° à 20° Ouest et N10° Est : faille d’Argentat
entre Bagnac et Bouillac, le Grand Sillon Houiller, la zone de moindre
résistance de Lugan-Livinhac
- N 30° Ouest : synclinal de la Gaillardie, la brèche du Vignier d ’Agnac
- N 40° à 50° Ouest : failles issues de la faille d’Argentat et la prolongeant vers le SE
Les premiers dépôts se sont donc accumulés dans une dépression étroite
et peu profonde allongée Nord-Sud qui et devenue par la suite la
cuvette principale.
Au cours de son fonctionnement, le bassin de Decazeville offre des exemples très précis d’enchaînements
entre les phénomènes de subsidence, d’érosion et de sédimentation.
Les
phases de subsidence brutale sont plus importantes que dans la plupart
des bassins du Massif Central, qui ne connaissent pas la répétition
d’arrivées détritiques aussi massives, interrompant brusquement les
phases de sédimentation phytogène. Ces mouvement saccadés sont peut être dûs à la mise en place des granites avoisinant le
bassin.
|

Carte schématique indiquant les grands traits de la tectonique anté-stéphanienne
(Thèse P. Vetter, Tome 1 p : 279)
|
Les
principales déformations subies par le contenu stéphanien sont
contemporaines du remplissage du bassin. Les mouvements
post-stéphaniens ont accentué les déformations ébauchées mais sans
imposer un style tectonique différent :
- Au début du dépôt de l’assise de Bourran, le bassin a subi un mouvement
de compression latérale dirigé d’Ouest en Est qui a redressé la bordure
Ouest, déterminant ainsi des axes synclinaux et anticlinaux
à grand rayon de courbure, sensiblement parallèles aux bordures du bassin. Le charbon a commencé à
fluer dans les anticlinaux. Cette disposition s’accentuera avec la
tectonique post-stéphanienne (ex : anticlinal de Lassalle, exploité dans la Grande Découverte, observable en coupe dans la partie historique).
- Au Permien, la subsidence semble s’être arrêtée et une seconde phase de
plissement a probablement eu lieu, accentuant les structures
antérieurement ébauchées.
- Enfin, la tectonique tertiaire en relation
avec les mouvements alpins, a affecté le Houiller et l’Oligocène dans
la région Nord du bassin, en faisant rejouer les failles antérieures. |
|